
20 ans de Chine à l'OMC: comment le dragon a su jouer avec brio la carte du libre-échange international
Ces deux dernières décennies, la Chine a connu un véritable « miracle économique » par lequel elle est devenue le plus important exportateur de biens au monde. Un succès qu’elle doit en partie à son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en décembre 2001, il y a 20 ans.
Le 11 décembre 2001, après quinze années d'efforts, l’empire du Milieu rejoignait l’OMC (l'Organisation mondiale du commerce) sous les applaudissements des 143 États membres qui la composaient alors, lors d’une cérémonie célébrée en grande pompe. Vingt ans plus tard, c'est un anniversaire resté relativement discret. Ce contraste surprenant acte d'une désillusion des pays occidentaux vis-à-vis d'une Chine qui a été la grande gagnante de cette adhésion, dans un contexte nouveau de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis où le multilatéralisme célébré jadis est aujourd'hui en souffrance. Mais que s’est- il donc passé durant ces vingt années et comment la Chine a-t- elle sorti son épingle du jeu du libre-échange ?
Un piège auquel la Chine a su échapper

Terminal à conteneurs de Yantian, à Shenzhen © Chen Wen/CNS
L'arrivée de la Chine à l'OMC s'est faite dans un contexte particulier : celui du débat opposant les pays du Nord à ceux du Sud au sujet du commerce international. Si les premiers exportent des biens à forte valeur ajoutée, comme des services ou des hautes technologies, les seconds exportent des biens à faible valeur ajoutée, bien souvent des matières premières ou des produits agricoles. Le rôle de l’OMC, consistant à lever un maximum de barrières aux échanges commerciaux, pose donc un problème d’équité. Les pays du Sud doivent payer plus cher pour acheter les biens produits au nord, et, à l’inverse, ils sont assignés à un rôle d’exécutant, de fournisseurs de matières premières à tarif avantageux pour les pays du Nord. De même, la concurrence exercée par l’importation de produits à bas coût conduit certains producteurs locaux à la faillite. Dans les pays du Sud, ce sont souvent des millions de petits paysans qui en payent le prix. Il en résulte un cercle vicieux : les pays riches restent riches, les pays pauvres restent pauvres.
Dans une interview accordée à Xinhua le 6 décembre dernier, Sun Zhenyu, premier représentant permanent de la Chine à l'OMC, a rappelé justement que l’adhésion de la Chine à l’OMC en 2001 avait coïncidé avec le cycle de négociations de Doha à l’OMC. Pleins d’optimisme pour l’avenir, les pays en développement militaient alors en faveur d’un « droit au développement ». Ils s’opposaient à l’abaissement systématique de leurs tarifs douaniers et à l’assouplissement des conditions d’accès à leurs marchés intérieurs en fonction de leurs situations propres.
L’ancien diplomate a rappelé comment les débats avaient porté également sur la propriété intellectuelle : les brevets des pays du Nord sur les médicaments et autres vaccins constituaient un vrai défi de santé publique pour les pays du Sud. La Chine agissait comme l’un de leurs porte- voix. Elle militait pour qu’ils bénéficient de conditions avantageuses ou de certaines dérogations. Vingt ans après le début du cycle de Doha, presque rien n’a changé.
Lorsque la Chine a déposé sa candidature au GATT en 1986, elle était un pays du Sud à part entière. Son PIB par habitant était plus bas que celui de l’Inde et même 7 fois inférieur à celui du Brésil (Banque mondiale). Elle a pourtant réussi à échapper à ce fameux cercle vicieux en élaborant une triple stratégie commerciale : elle a tout d’abord délaissé l’agriculture au profit de l’industrie en s’appuyant sur le faible coût de sa main-d'œuvre, attirant un maximum d’investissements étrangers. De quoi générer des excédents utilisés par l’État pour soutenir ses « champions nationaux » de l’industrie chinoise, sous forme de subventions. Enfin, elle a conditionné l’accès à son marché intérieur à des transferts de technologies. Grâce à cette politique et en moins de 20 ans, la Chine a remonté toute la chaîne globale de l’innovation, avec Shenzhen, la « Silicon Valley chinoise », comme vitrine de ce miracle chinois (cf. Le 9 n°28, mai 2020).
Le temps de la désillusion ?
La place de l’empire du Milieu dans l’économie mondiale n’a donc cessé de croître passant de 4 % en 2001 à 17,4 % en 2020. Dans un tel contexte, l’ère des compromis à l’OMC a subitement tourné court.
Au départ, le monde occidental n’y a vu que du feu. Dans une interview récente citée par le Global Times, le spécialiste américain en relations internationales John Mearsheimer a rappelé que les États-Unis soutenaient largement l’adhésion de la Chine à l’OMC dans les années 1990. Ils voyaient en elle un Eldorado pour leurs entreprises, notamment en raison d’un marché colossal de plusieurs centaines de millions de consommateurs potentiels. Beaucoup pensaient aussi que la Chine allait ainsi suivre la voie du libéralisme politique, pour se rendre compte aujourd'hui à quel point le pays reste politiquement ancré dans son système socialiste. Dès l'adhésion, les pays occidentaux ont très vite négocié avec elle l’abaissement de ses droits de douane. Le plus souvent, des compromis ont été trouvés. La Chine a ainsi diminué ses droits de douane sur les voitures de 80 à 25 % entre 2001 et aujourd’hui. Les désaccords ont porté à l’époque surtout sur des questions de délais : les autorités chinoises voulaient que ces niveaux de fiscalité soient atteints en 2008, tandis que les États-Unis militaient en faveur d’une échéance à 2005. L’année 2006 avait finalement été retenue au terme de longues négociations.Xinhua a rappellé comment la Chine a par la suite rempli tous ses engagements en matière de droits de douane sur l’ensemble des biens en 2010, avec un niveau tarifaire moyen de 9,8 % contre 15,3 % en 2001. Aujourd’hui, ce niveau est de 7,4 %.
Comme au judo, en utilisant la force de son adversaire, l’économie chinoise a gagné son pari. La place de l’empire du Milieu dans l’économie mondiale n’a donc cessé de croître depuis 2001, passant de 4 % en 2001 à 17,4 % en 2020 (Global Times), son propre PIB ayant été multiplié par 8. Dans un tel contexte, l’ère des compromis à l’OMC a subitement tourné court : les États-Unis ont commencé à contester les pratiques commerciales de la Chine auprès de l’organe de règlement des différends de l’OMC, affirmant que les prix des biens qu’elle produisait violaient toutes les règles de la concurrence, engendrant même la désindustrialisation des pays du Nord. Comme le rappelle le média financier chinois yicai.com, c’est l’arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2017 qui a finalement mis un point d’orgue à ces plaintes : en mars 2018, ce dernier a unilatéralement imposé des droits de douane sur les importations d’aluminium, invoquant un motif de « sécurité nationale ». La guerre commerciale était lancée, pavant la voie à une nouvelle ère pour l’OMC : celle du repli sur soi et du retour à l’unilatéralisme. Si l’arrivée au pouvoir de Joe Biden semble modérer cette attitude dans les négociations entre les États-Unis et la Chine, il n’en reste pas moins que la boîte de Pandore a été ouverte.
Le discours d'une Chine responsable de la désindustrialisation du Nord est aujourd’hui un argument de plus en plus répandu au sein des pays du Nord. Ceux-ci s’inquiètent des conséquences d'un libre-échange, dont ils avaient pourtant eux-mêmes chanté les louanges à l’époque où ces pays étaient majoritaires à l’OMC.
Or l’organisation a évolué et compte aujourd’hui 160 membres dont la plupart sont désormais des pays du Sud revendiquant un « droit au développement », plaçant l’OMC dans une impasse. Il semblerait que la négligence originelle de la reconnaissance des revendications des pays du Sud soit un vrai retour de boomerang pour les pays occidentaux. Doit-on vraiment imposer ces mêmes règles intangibles du libre-échange à tous les pays du monde, sans tenir compte de leurs particularités et de leurs niveaux de développement respectifs ?
À l’heure du variant « Omicron » venu d’Afrique du Sud, le fait que les pays du Sud demeurent moins vaccinés contre la Covid-19 que ceux du Nord montre toute la limite d’un tel système. En décembre dernier, lors de la 12e conférence ministérielle de l'OMC, l’Union européenne a rejeté la proposition de nombreux pays du Sud portant sur la levée provisoire des brevets des vaccins contre la Covid-19 (yicai.com), marquant un nouvel échec des négociations commerciales, la sacralisation des droits de propriété sur les brevets de vaccins supplantant le bon sens d’une politique globale de santé publique. La crise épidémique nous montre que les règles du jeu seraient peut-être à revoir, sans forcément chercher à sanctionner les joueurs.
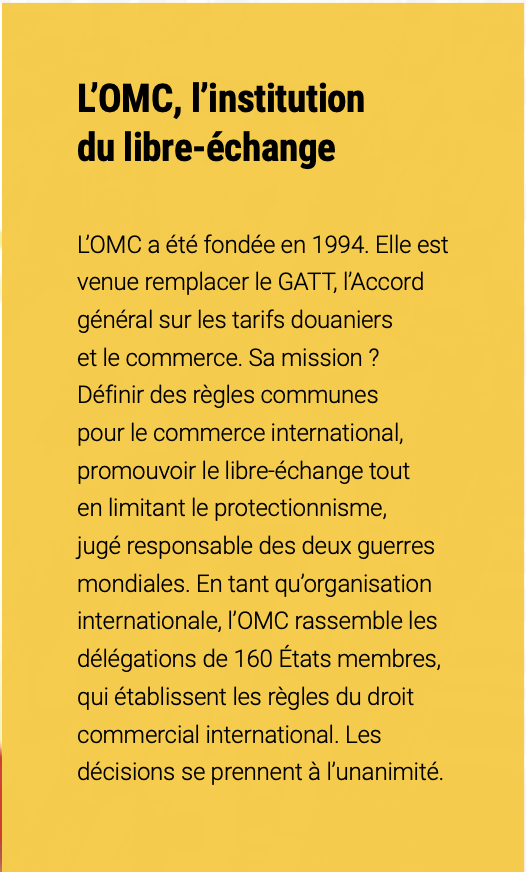
Photo © SHENG Jiapeng/CNS
Commentaires